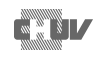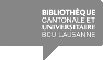La législation climatique en mutation : place aux principes de cohérence, d’évaluation et de mobilisation du public
Details
State: Public
Version: Final published version
License: Not specified
Serval ID
serval:BIB_2BF1B2637CBD
Type
A part of a book
Collection
Publications
Institution
Title
La législation climatique en mutation : place aux principes de cohérence, d’évaluation et de mobilisation du public
Title of the book
Environnement, climat. Principes, droit et justiciabilité
Publisher
Helbing Lichtenhahn
Publication state
Published
Issued date
01/11/2024
Pages
201-242
Language
french
Abstract
Introduction
Tel qu’il ressort notamment de l’art. 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’accès à la justice constitue l’une des conditions essentielles pour qu’une personne puisse faire valoir les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. En son absence, les citoyennes et les citoyens ne peuvent se
faire entendre, exercer leurs droits, contester des actes arbitraires, discriminatoires ou plus généralement contraires au droit, ni engager la responsabilité des autorités. Ce droit procédural permet de saisir l’organe chargé de veiller à la régularité dans un système juridique, de sorte que les particuliers « ne soient pas simplement assujettis à un
pouvoir exécutif de plus en plus puissant », mais puissent accéder à une autorité indépendante. Il s’inscrit dès lors dans un litige entre deux parties, que le juge doit résoudre
en tranchant un différend relatif à l’application du droit.
Le besoin accru de protection juridique dans le domaine de l’environnement souligne la dichotomie grandissante entre ce qui est attendu par les justiciables – au regard de
leur propres aspirations, de l’urgence ou des promesses qui leur sont faites – et ce qu’ils perçoivent de l’action publique et de la mise en oeuvre des exigences légales. En d’autres
termes, il souligne qu’une partie de la population considère l’action climatique des autorités exécutives, voire législatives, comme insuffisante, non pertinente et bien plus
encore comme illégale. L’insuffisance peut concerner la concrétisation des intentions et des engagements internationaux dans des actes concrets, la prise en compte partielle ou
tronquée des intérêts en jeu ou encore l’inadéquation entre le cadre scientifique et juridique et les mesures engagées. Elle concerne tant l’intensité des mesures telle que des
seuils d’émissions inadéquats, leur étendue lorsque des activités ne font l’objet d’aucune mesure ou le type des mesures. Les administrés attendent alors de la justice qu’elle
constate cette insuffisance et rappelle les autorités à leur devoir, de manière à infléchir ou contraindre la formation des politiques climatique et environnementale.
Le thème de l’accès à la justice interroge sur la place et le rôle réservés aux citoyennes et aux citoyens en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le changement
climatique. Lorsque leur avis ou leurs intérêts n’ont pas été suffisamment pris en considération, que leurs droits fondamentaux – droit à la vie, à la santé, à un environnement
sain – sont négligés, elles et ils les défendent par la voie contentieuse. Le public se situe toutefois dans une position de relative faiblesse, pour le moins son action climatique
reste-t-elle avant tout réactive et indirecte.
Dans cette perspective, la présente contribution ouvre la réflexion sur une refonte de la manière de penser les politiques climatiques, non pas dans ses fondements juridiques,
mais dans la manière de les concevoir et de les concrétiser dans des règles de droit.
Les développements récents du droit européen offrent à notre sens une excellente source d’inspiration, bien qu’ils soient encore en phase de construction. Ils permettent
de positionner certains principes généraux d’une importance cardinale destinés à gouverner les politiques climatiques, de leur élaboration à leur mise en oeuvre. Ces principes
soudent des stratégies environnementales de l’Union, mais également de celles de la Suisse – bien que de manière plus évanescente (infra II). Le principe de cohérence
ouvre la voie à une vision intégrée et globale de la réponse à apporter à l’urgence climatique (infra III). Cette vision est indissociable d’une approche dynamique impliquant
l’évaluation continue de l’efficacité et de l’effectivité des mesures (infra IV). Finalement, les instruments de la transparence et de la démocratie participative permettent de
repenser l’action citoyenne dans le débat climatique (infra V).
Tel qu’il ressort notamment de l’art. 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’accès à la justice constitue l’une des conditions essentielles pour qu’une personne puisse faire valoir les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. En son absence, les citoyennes et les citoyens ne peuvent se
faire entendre, exercer leurs droits, contester des actes arbitraires, discriminatoires ou plus généralement contraires au droit, ni engager la responsabilité des autorités. Ce droit procédural permet de saisir l’organe chargé de veiller à la régularité dans un système juridique, de sorte que les particuliers « ne soient pas simplement assujettis à un
pouvoir exécutif de plus en plus puissant », mais puissent accéder à une autorité indépendante. Il s’inscrit dès lors dans un litige entre deux parties, que le juge doit résoudre
en tranchant un différend relatif à l’application du droit.
Le besoin accru de protection juridique dans le domaine de l’environnement souligne la dichotomie grandissante entre ce qui est attendu par les justiciables – au regard de
leur propres aspirations, de l’urgence ou des promesses qui leur sont faites – et ce qu’ils perçoivent de l’action publique et de la mise en oeuvre des exigences légales. En d’autres
termes, il souligne qu’une partie de la population considère l’action climatique des autorités exécutives, voire législatives, comme insuffisante, non pertinente et bien plus
encore comme illégale. L’insuffisance peut concerner la concrétisation des intentions et des engagements internationaux dans des actes concrets, la prise en compte partielle ou
tronquée des intérêts en jeu ou encore l’inadéquation entre le cadre scientifique et juridique et les mesures engagées. Elle concerne tant l’intensité des mesures telle que des
seuils d’émissions inadéquats, leur étendue lorsque des activités ne font l’objet d’aucune mesure ou le type des mesures. Les administrés attendent alors de la justice qu’elle
constate cette insuffisance et rappelle les autorités à leur devoir, de manière à infléchir ou contraindre la formation des politiques climatique et environnementale.
Le thème de l’accès à la justice interroge sur la place et le rôle réservés aux citoyennes et aux citoyens en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le changement
climatique. Lorsque leur avis ou leurs intérêts n’ont pas été suffisamment pris en considération, que leurs droits fondamentaux – droit à la vie, à la santé, à un environnement
sain – sont négligés, elles et ils les défendent par la voie contentieuse. Le public se situe toutefois dans une position de relative faiblesse, pour le moins son action climatique
reste-t-elle avant tout réactive et indirecte.
Dans cette perspective, la présente contribution ouvre la réflexion sur une refonte de la manière de penser les politiques climatiques, non pas dans ses fondements juridiques,
mais dans la manière de les concevoir et de les concrétiser dans des règles de droit.
Les développements récents du droit européen offrent à notre sens une excellente source d’inspiration, bien qu’ils soient encore en phase de construction. Ils permettent
de positionner certains principes généraux d’une importance cardinale destinés à gouverner les politiques climatiques, de leur élaboration à leur mise en oeuvre. Ces principes
soudent des stratégies environnementales de l’Union, mais également de celles de la Suisse – bien que de manière plus évanescente (infra II). Le principe de cohérence
ouvre la voie à une vision intégrée et globale de la réponse à apporter à l’urgence climatique (infra III). Cette vision est indissociable d’une approche dynamique impliquant
l’évaluation continue de l’efficacité et de l’effectivité des mesures (infra IV). Finalement, les instruments de la transparence et de la démocratie participative permettent de
repenser l’action citoyenne dans le débat climatique (infra V).
Create date
18/12/2024 9:48
Last modification date
19/12/2024 7:12